Préserver le
patrimoine scolaire…
Oui, mais pour quoi ?
par Patrick PLUCHOT
Président de
l’association du Musée de la Maison d’Ecole
écomusée- Musée de
France
Montceau-les-Mines
Histoire
de l’école et recherche historique
La première école publique de
Montceau-les-Mines, l’école du Centre qui abrite notre musée, fut construite entre
1878 et 1881. Elle est issue d’une volonté politique propre à la municipalité
radicale du Docteur Jeannin d’une part, mais aussi d’une dynamique républicaine
insufflée par Jules Ferry qui va favoriser l’implantation sur le territoire
français de 75 000 établissements qui lui sont semblables. C’est la volonté
ministérielle qui va en définir le contenu, les méthodes, les objectifs
d’enseignement, ainsi que la formation de ses maîtres. Sa jumelle, l’école de
filles de la rue Centrale ouvrira ses portes en 1882.
Les forces économiques, sociales, politiques
de la nation ont donc présidé à cette éclosion. De fait, toute étude
monographique comporte deux risques majeurs : d’un côté, elle risque de
n’être que le reflet microcosmique de l’histoire nationale mille fois répétée
dans les lieux qui la composent, mais d’un autre, elle risque de ne s’ancrer
que dans le seul contexte communal, à l’exclusion de tout autre, régional ou
national.
On est en droit, dès lors, de s’interroger
sur la légitimité et la place que tient l’étude monographique de l’école
publique à Montceau dans la recherche en histoire de l’éducation. Principalement,
l’histoire de l’éducation est composée de plusieurs courants de pensée.
Le premier a sans doute été politique, porté
par l’impulsion républicaine de 1870 à 1880 et la mise en place de l’école
laïque. L’histoire de l’enseignement fut sollicitée pour apporter des arguments
aux adversaires en présence. Il s’agissait, pour certains de montrer
l’importance de l’œuvre accomplie par l’Eglise et la Monarchie depuis des
siècles et pour d’autres d’en souligner les archaïsmes et les retards en
reprenant l’œuvre avortée des révolutionnaires de 1789. On retrouve cette
facette politique dans l’approche du problème de l’école par la petite
bourgeoisie des années 1970, frustrée dans ses espérances de promotion sociale.
Le rôle et les fonctions de l’école de la République, à cette époque, ont été
remis en cause, notamment par les thèses de Michel Foucault : l’école
était, selon lui, plus un dispositif de déculturation, de contrôle et de
dressage, qu’un instrument de diffusion de connaissances et d’émancipation.
Le second courant se veut plus pédagogique,
même si l’histoire de la pédagogie a souvent été, par le passé, d’inspiration
plus philosophique et morale que proprement historique. Ce courant s’oriente
désormais vers la perspective d’une histoire institutionnelle ou sociologique
plus que purement idéologique. Il pose la problématique du rôle de l’histoire
de l’éducation et du rôle de l’étude de l’histoire des disciplines dans la
formation des maîtres. Ces derniers ne sont-ils pas sous-estimés ? Ces
deux approches du métier ne permettraient-elles pas d’estomper cette mentalité
spontanément imprégnée de l’illusion d’éternité qui fait apparaître comme transhistoriques
les contenus, les méthodes et les objectifs de l’enseignement ? Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si les études sur l’histoire des disciplines scolaires
ne se sont principalement attaché qu’aux disciplines qui posent aujourd’hui le
plus de problèmes à ceux qui les enseignent : l’éducation physique, avec
l’ambiguïté de son statut disciplinaire, et le français, dont les objectifs et
les méthodes, longtemps incontestés, sont battus en brèche par les
bouleversements sociologiques et les nouveaux médias. Pour comprendre les
évolutions ou les ruptures actuelles, les enseignants doivent s’intéresser au
passé de l’éducation et, par conséquent,
au passé des disciplines qu’ils enseignent.
Le troisième courant plus récent, celui qui
nous guide dans notre action, est celui de l’histoire sociale et de la
sociologie historique de l’éducation. Il tend à expliquer les fonctionnements
qui lient l’histoire de l’école aux mécanismes de la reproduction sociale et à
la formation des mentalités collectives. L’accent est mis sur la sociologie des
élèves et des enseignants, sur le discours éducatif analysé à partir des textes
et directives officielles, des manuels et de la presse pédagogique. En
multipliant les études régionales, ce courant a rendu indispensable le recours
à la dimension comparatiste.
C’est donc autour de cette recherche
diversifiée que se sont forgés les objectifs du Musée de la Maison
d’Ecole : rédaction d’une monographie, création d’un musée d’éducation et
constitution, même modeste, d’un conservatoire éco muséographique. Ces
objectifs doivent, au demeurant, intégrer les grandes orientations qui
régissent les musées de France et les collections nationales : élaboration
d’un projet scientifique, d’un projet culturel et d’un projet organisationnel.
Il existe,
depuis de nombreuses années et en de nombreux lieux, une tradition
monographique aux finalités essentiellement commémoratives et apologétiques,
mais la Maison d’Ecole est animée par
des ambitions plus hautes car nous pensons que la vocation spécifique et
irremplaçable de l’histoire locale est de se donner pour étude le vécu
scolaire. Notre intime conviction est que nous devons nous constituer en
observatoire et en conservatoire du vécu des enseignants et des élèves, de
l’attitude des populations, non pas envers l’école, mais envers leur école.
Cette observation du milieu scolaire si particulier du Bassin minier et de ses
écoles antagonistes (école publique et école des mines) passe par l’analyse des
pratiques pédagogiques. Ces pratiques se traduisent dans les rapports
psychologiques, affectifs et sociaux entre élèves et instituteurs sachant que
le vécu scolaire ne s’arrête pas aux
portes de l’école, il se prolonge dans la famille. Quels échos, quels soutiens,
quelles résistances l’instruction et l’éducation scolaire recevaient-elles dans
le milieu familial ? Quelles intentions du législateur et quels contenus
des programmes les enfants acceptaient-ils ou retenaient-ils ? Autant de
questions qui montrent l’importance de la sauvegarde et de la préservation
locales des cahiers et travaux des élèves de toutes époques et l’importance
aussi de leur analyse qui permet de cerner la façon dont ceux-ci satisfaisaient
ou non aux normes officielles. Les témoignages oraux ont aussi leur valeur, dès
lors qu’ils sont filtrés de toute nostalgie ou folklore qui autoriseraient la
formulation malencontreuse de jugements de valeur sur la nature et le sens de
l’évolution vers l’école d’aujourd’hui. De même, la dimension comparatiste doit
faire de notre monographie un singulier qui renvoie à un pluriel, au lieu de
l’anecdotique qui ne renvoie à rien.
Vers une ethnologie du patrimoine scolaire
L’école de 1881 n’appartient pas tout à fait
à un monde que nous aurions perdu, mais le développement accéléré de ce qu’on
appelait encore il y a peu « l’école parallèle » nous convainc que
les bancs de l’école ne sont plus les lieux uniques de la transmission du
savoir.
Qu’est devenue l’exaltation des
commémorations du Centenaire des lois Ferry trente-cinq ans plus tard ? En 1981, gouvernants et
opposants se disputent le droit à la célébration de l’événement, « Le
Centenaire des lois scolaires de la France n’est la propriété exclusive de
personne » dira le Ministre de l’Education de l’époque le 16 janvier 1981,
« Jules Ferry gouvernait au centre… ». A l’âge mûr, toute une
population se découvrait soudain des souvenirs communs, à défaut de valeurs
communes. L’école républicaine tentait de les rassembler tous et leur avait
donné durant leurs quelques années d’instruction publique, les rudiments
indispensables à leur rôle futur de citoyens-producteurs… alors que la famille,
et donc l’éducation reçue, établissait de solides distinctions entre les
enfants, selon leur classe sociale d’origine. Au de-là de l’analyse critique
des mécanismes idéologiques de cette école républicaine, notre vocation est
d’étudier, en ethno-historiens, tous les rouages de cette forme ethnologique
particulière, et historiquement située, qu’est l’école républicaine. Nous nous
devons de transmettre aux générations suivantes une image plus exacte, plus
contrastée et finalement plus pertinente de cette école. Comment pourrions-nous
sinon, à l’avenir, appréhender sereinement l’école d’aujourd’hui et ses
enjeux ?
Il convient de restituer une logique aux
lieux historiques présentés par le Musée de la Maison d’Ecole pour la période
1880 à 1920 que nous avons intitulée « Le temps des certitudes » afin
d’appréhender avec justesse les périodes qui ont suivi : « Le temps
des recherches » (1920 à 1970) et « Le temps des incertitudes »
(1970 à …). Une approche plus critique (bien que chargée d’affectif) des années
fondatrices de l’école républicaine, s’impose.
La
Maison d’Ecole :
La répartition des sexes se fait dans des
écoles différentes, de part et d’autre d’un mur (comme les travées d’une église),
le préau couvert est au centre du bâtiment, il remplit une fonction
« propédeutique » (comme le porche d’une église), le potager du maître induit, quant à lui, l’existence de
« leçons de choses » afin d’élever le niveau de connaissances
agricoles des petits élèves.
Dans la salle de classe, l’estrade et la
chaire du maître dominent la population enfantine, c’est la rationalisation du
lieu : l’Etat dominant les citoyens. Le tableau noir (couleur du sérieux,
celle des soutanes et des habits du Tiers-Etats) où s’inscrivent la date et la
maxime du jour, guide l’élève dans ses activités journalières. Au-dessus, les
planches didactiques et l’horloge (il fallait impérativement apprendre cette
heure industrielle si peu utile dans nos campagnes), à gauche l’armoire vitrée
du compendium unificateur, à droite la petite bibliothèque scolaire, aux livres
austères recouverts de toile, noire elle aussi, au sommet de laquelle trônent
le boulier et le globe terrestre.
Face à ce mur du savoir trois ou quatre rangs
parallèles de pupitres. Aux élèves, par leur travail et leur application, de
mériter leur place. Ainsi se justifie la cérémonie hebdomadaire de la
proclamation publique des résultats : chacun sait ce qu’il vaut par son
placement proche ou éloigné du maître. Le cancre se définit souvent par son
extraordinaire stabilité spatiale, il ne bouge jamais du dernier rang, il est
inapte à toute progression dans la classe et donc inapte à toute mobilité
sociale ultérieure. Le bon élève bénéficie de la meilleure place, près des
tableaux et des explications du maître.
Comment les élèves percevaient-ils
subjectivement cette répartition autoritaire ? Quelles relations subtiles
et durables reliaient les rangs du fond à ceux qui leur tournaient
continuellement le dos ? C’est la réponse à ces questions d’ethnologue qui
donne un réel sens à une muséographie authentique.
Les
techniques disciplinaires :
Techniques de stimulation et de
récompenses : félicitations, satisfactions, bons points, satisfecit et
prix annuels.
Techniques de réprobation et de
punitions : piquets, bonnet d’âne, châtiments corporels, lignes à copier,
bûche…
Là encore, l’objet est source d’évocation et s’il
faut entreprendre l’inventaire et l’archéologie des techniques de la
discipline, il convient surtout de faire l’inventaire des comportements
engendrés par l’arsenal disciplinaire.
Jusqu’à quelle profondeur de conscience, la
dichotomie pédagogique entre le bien récompensé et mal réprimé, a-t-elle marqué
les élèves ? Combien de révoltes sociales contre l’injustice tirent-elles
leurs origines dans la brutalité de l’Institution ? Combien, au contraire,
d’hommes furent marqués à jamais de la souveraine pondération de leurs maîtres
« sévères mais justes » ?
Les
techniques et les contenus pédagogiques :
Le musée s’attache à montrer l’évolution des
outils à travers les objets présentés, mais le complément essentiel à la visite
n’est-il de montrer l’enfant qui se cache derrière, seul face à ses
apprentissages ?
Il lui
faut lire
d’abord : individuellement dans un syllabaire, mais le plus souvent
collectivement sur une planche murale. L’épellation à haute voix est la règle,
l’oreille et l’œil de l’élève doivent s’habituer à l’énonciation des phonèmes
et cet apprentissage apparaît à beaucoup comme une contrainte culturelle forte dans laquelle ils perdent leur accent
et leur patois. En cela effectivement, l’école prépare au principe de réalité
et d’identité de la future vie d’adulte. Ce n’est qu’après la Grande Guerre que
verra le jour une méthode de lecture « en riant ». En attendant ce
jour, en même temps qu’il décrypte les lettres, l’écolier s’imprègne, à son
insu, de ces trois pôles de la vie sociale que sont le travail, la famille et
la patrie, bien avant que Vichy n’en fasse sa devise. Avec ou sans Dieu,
l’école fonctionne comme un système de
normalisation socio-culturelle. Je dois travailler, je dois aimer mes parents,
je dois défendre ma patrie… cette culpabilisation, héritée de 1870,
intériorisée sur les bancs de la communale, n’explique-t-elle pas l’union
sacrée d’août 1914 ?
Il lui
faut écrire
ensuite : l’art d’écrire à la plume et à l’encre est une calligraphie qui
ne peut être que mécanisée et ainsi s’acquérir lentement comme l’écrira
Péguy : «Au lieu de nous faire écrire des mots, comme tout le monde, ou
tout au moins des lettres, le maître nous faisait écrire des bâtons ridicules
indéfiniment, et des jambages, et des boucles (…). Je me soumettais austèrement
par discipline ; pour la première fois de ma vie je connus l’arrière-goût
amèrement bon de l’obéissance pénible voulue ». La recherche de
l’application est constante et masque momentanément ce que l’on a appelé à la
fin du XIXème siècle « la dégradation de l’écriture », voilà que
déjà, la massification de cet apprentissage avait rendu certains nostalgiques
de l’élite des « belles mains » : les copistes d’antan. On
retrouve cependant cette tradition perpétuée dans les cahiers des meilleurs
élèves (souvent les seuls qui ont traversé le temps) et surtout dans les
cahiers de roulement. A l’âge adulte, on jouait sa carrière professionnelle sur
une belle page, le « curriculum vitae » manuscrit d’aujourd’hui en
reste le dernier avatar. Les maîtres exigeaient le « savoir écrire »,
certes, mais sans fautes, en « français national ». En cela réside le
progrès, le citoyen aura accès à une communication élargie dans le temps (les
grands auteurs lui sont accessibles) et dans l’espace (il pourra écrire ces courriers qui brisent
la solitude sociale, morale et culturelle de tout analphabète). Savoir lire et écrire
en français est tout aussi indispensable au mouvement ouvrier naissant qu’à
l’affirmation politique du suffrage universel.
Il lui
faut obligatoirement compter : nation d’ouvriers ou de petits
entrepreneurs (agricoles, artisanaux ou commerciaux), la France enseigne à ses
fils les vertus de l’épargne, de l’accumulation du patrimoine et de sa
transmission héréditaire. Le savoir-compter est la formation sociale de
l’industrialisation prônée par les économistes positivistes de cette fin du
XIXème siècle : calculer une surface foncière, estimer rapidement les
intérêts composés d’un capital placé à taux fixe. Les exercices de calcul
scolaires quittent rarement le terrain des réalités matérielles familières,
mêmes celles des familles prolétaires. De fait, les apprentissages de l’école
primaire obligatoire n’entraient que rarement dans le domaine de l’abstrait et
de l’inobservé.
Les
rites scolaires :
L’école a secrété ses rites d’identification
et d’intégration. Le plus grand est sans nul doute celui de la rentrée, il
implique autre chose qu’un simple retour de vacances ou que des débuts timides
à l’école. C’est d’abord un rite de normalisation vestimentaire. Tout est neuf,
tout est beau pour aborder le domaine de la culture. C’est la découverte ou le
retour à la discipline et à l’agressivité collectives, force des armées au
passage : au coup de sifflet ou de claquoir, on cesse de jouer, on se met
en rang par taille, on rentre au pas dans la classe. Même sans aucun exercice
de maniement d’armes ou sans existence de bataillons scolaires, l’école
publique forme le soldat-citoyen. Même dans la cour de récréation, l’écolier
découvre l’ambivalence de la solidarité réconfortante de sa bande et
l’agressivité inquiétante des bagarreurs.
« Quel est ton nom ? »,
immédiatement le maître dénomme l’enfant et le renvoie à une identité
patronymique peu usitée dans toute sa petite enfance.
Le souvenir collectif se trouve conservé, dès les débuts de la Troisième
République, par la photo de classe rituelle. Les enfants endimanchés posent
autour de leur maître avec pour unique destin de prouver qu’ils étaient là,
comme naguère les grognards d’Austerlitz… Les photographies restent un
témoignage ethnographique majeur : nombre d’élèves par classe, répartition
des divisions, les informations fournies vont de l’habillement (habits
bourgeois ou imités du bourgeois, tenue du maître, sarraus, uniformes, crânes
tondus, pieds nus, sabots ou galoches) jusqu’aux yeux exorbités des enfants
d’alcooliques.
La confrontation d’un membre survivant à sa
photo de classe est le prélude à une remémoration orale des mœurs et des
coutumes de cet écolier d’hier et c’est une technique indispensable à une
véritable ethnographie de la France de
l’école obligatoire. De même, l’exploitation d’un autre grand rite scolaire
qu’est l’appel bi-quotidien des présents met en lumière le champ social d’une
époque. Les annotations du cahier d’appel et les mots manuscrits des parents
reflètent de tout temps l’état sanitaire ou les priorités sociales des
familles. La variété ahurissante des bouts de papier « portés au
maître », leur graphie et leur orthographe sommaires, les explications
rocambolesques parfois permettent d’appréhender la distance abyssale qui sépare
l’école institutionnelle et le milieu familial de certains élèves. Les causes
évoluant nécessairement, le constat reste le même de nos jours.
Conclusion :
Si la collecte méthodique des objets que nous
avons entreprise depuis quatre décennies a son importance, elle ne saurait être
une fin en soi. On voit bien que la tâche des muséographes du monde scolaire ne
s’arrête pas là. Elle doit évidemment contrer l’actuelle vague d’antiquaillerie
« rétro » qui aboutit uniquement à élargir la sphère des valeurs
marchandes et à appauvrir les collections nationales, mais sa tâche est aussi
d’aider l’ethnohistoire dont nous nous réclamons à installer les objets du
musée dans le flot vivifiant des discours et des pratiques en perpétuelle
évolution, afin que les générations appelées par la République à entrer dans le
monde de la culture et du progrès sachent bien quel chemin a été parcouru
depuis les lois Ferry de 1882 et pourquoi.
Pour
une méthode d’analyse des phénomènes scolaires
Si, l’école est liée aux caractères d’un
certain type de société, la socialisation s’effectue de moins en moins selon la
forme scolaire et il est bon de se rappeler que l’école n’est ni universelle,
ni éternelle. L’école est une combinaison spécifique d’éléments qu’il convient
de définir, il faut montrer comment elle s’est constituée progressivement et tenter de restituer cette structure dans
sa totalité sociale et historique. Il ne faut ni rester dans un pur inventaire,
ni s’enfermer dans la querelle de jugement de valeur qui opposa les partisans
de l’école libératrice aux dénonciateurs de l’école-prison durant la période
que nous avons appelée « Le temps des recherches ». Il s’agit de
comprendre les changements passés et présents, les variations durables ou
éphémères d’une école qui est loin d’être immuable. Cette tâche nécessite, à
notre sens, quelques notions et une méthode.
Les
notions :
L’apparition des « Maison d’école »
en 1882 établit un rapport social spécifique : la relation pédagogique. Ce
nouveau rapport maître/écolier se distingue du rapport Maître/disciple,
maître/compagnon ou même du rapport prêtre/initié. Son émergence est liée
historiquement à la transformation des autres rapports sociaux dans le domaine
du politique, de l’économique et de la religion.
On peut oublier cette spécificité en
définissant cette relation comme une transmission entre « celui qui sait
et celui qui ne sait pas », mais ce serait méconnaître la diversité des connaissances transmises et
les formes selon lesquelles elles sont transmises, la « discipline
scolaire » n’a l’unique fonction que de favoriser la transmission du
savoir et du savoir-faire. On universalise l’école en niant qu’en d’autres
temps et dans d’autres sociétés, cette transmission ait pu être non scolaire.
On peut aussi oublier cette spécificité en
n’y voyant qu’un aspect de la contrainte qu’exerce la société sur les individus
qui la composent. On peut tenter d’expliquer les méthodes pédagogiques par la
contrainte du « social », mais c’est penser que l’école est éternelle
et oublier que les rapports sociaux eux-mêmes se transforment et évoluent. On
aboutit alors à un conservatisme stérile.
Prenons donc comme hypothèses la pluralité
des modes de socialisation, la spécificité de la forme scolaire et la diversité
des formes pédagogiques, on se donne ainsi des moyens sûrs de comprendre les
variations de l’école.
L’école de Jules Ferry ne doit pas être
considérée que comme le fruit d’une conjonction d’événements marqués par la
Commune, la défaite de 1870 ou l’arrivée des Républicains. Si les lois de 1880
à 1886 introduisent un cadre d’apprentissage formidablement nouveau dans les
campagnes, il n’en est pas de même dans les villes, car là, l’école publique
est en concurrence directe avec une autre école déjà existante : celle des
Frères des écoles chrétiennes apparue dès le XVIIème siècle et que la Restauration
avait étendue en favorisant les congrégations enseignantes. L’urbanisation
engendrant déjà des désordres, cette ancienne école devait les combattre et
s’était développée en même temps que les villes. On notera à cet égard, une
similitude de situation avec les écoles à Montceau-les-Mines : l’école
patronale de la mine de Jules Chagot, encadrée par les Sœurs de
Saint-Vincent-de-Paul et les Frères Maristes, dont le but inavoué était la
sécurisation sociale et politique du Bassin minier. Ces écoles chrétiennes
participèrent d’une nouvelle forme de rapports politiques : elles
célébrèrent dès 1830 la monarchie constitutionnelle, alors que l’école publique
de 1880 fut chargée de diffuser les principes républicains et patriotiques, ces
deux écoles, à leur heure, furent une pièce essentielle d’un type de pouvoir
particulier : le pouvoir d’Etat. On voit bien ainsi que la mise en
relation de l’école et de ses transformations avec les transformations
économiques n’est pas suffisante, le rapport entre le pédagogique et le
politique est étroit. De plus, c’est ce rapport étroit qui permet de comprendre
l’évolution pédagogique. Si le développement de l’école doit être fixé au
XVIIème siècle, il ne faut pas sous-estimer les ruptures pédagogiques du XIXème
siècle et l’avènement d’une pédagogie nouvelle, qu’à partir de 1878, les
inspecteurs et le Bulletin de l’Instruction imposeront.
Les hypothèses retenues ici n’admettent que
peu l’idée trop vague selon laquelle l’école refléterait la société, elles
mettent l’accent sur les variations des formes pédagogiques, elles permettent
d’interpréter ces variations et devraient, pourquoi pas, induire de nouvelles
formes d’enseignement.
La
méthode :
Quelle méthode d’analyse adopter alors face à
ces hypothèses ? Une méthode dialectique assurément, pour ne pas effacer
les contrastes qui expliquent les jugements opposés sur l’école, et pour
reconstruire une totalité à travers les
contradictions. Toute chose admet son contraire avant de s’affirmer.
Prenons le cas de l’enseignement des sciences :
les écoles furent équipées très tôt d’un matériel destiné à réaliser des
expériences scientifiques. A l’époque d’Emile Combes, plus particulièrement, ce
que l’on a appelé les « Catéchismes républicain » montraient aux
instituteurs réputés anti-cléricaux, comment utiliser la science pour lutter
contre l’obscurantisme et la superstition. Plus modestement les Instructions
Officielles voient dans la science à l’école primaire une « étude
libératrice de l’esprit », la science « écarte le surnaturel et le
miracle », toute affirmation doit être passée au crible de la raison. Mais
voilà que dans la pratique, cette orientation a du mal à s’appliquer. Le
rapport que l’école entretient avec les rapports entre classes sociales s’y
oppose : l’école primaire a en majorité affaire à des enfants d’origine
sociale modeste à qui elle doit apporter des connaissances pratiques durant
leur courte scolarité… on orientera donc cet enseignement vers des
connaissances « usuelles ». D’autre part, et ce, implicitement, des
craintes se fondent : jusqu’où pourrait aller l’idolâtrie de la science,
la recherche de la vérité et la remise en question des préjugés ?
Observons donc la nature sous forme de leçons de choses. L’écolier doit
apprendre qu’il y a des lois de la nature et qu’il doit s’y soumettre. Ainsi
passe-t-on d’un citoyen éclairé à un bon citoyen, respectueux des lois et de
l’ordre. Nous revenons alors à la « discipline » d’enseignement et
l’écolier apprend à se soumettre à la règle.
Autre exemple, si la « communale »
a contribué largement à la formation d’une conscience patriotique, avec ou sans
bataillons scolaires, elle a aussi, d’une manière diffuse, provoqué par
l’accession au savoir, le refus de certaines formes de militarisme. Les
collèges de jésuites sous l’Ancien Régime avaient pu produire des penseurs
révolutionnaires, l’école primaire, les écoles primaires supérieures et les
écoles normales ont pu produire à leur tour, des instituteurs pacifistes, qui
furent malgré tout d’ardents patriotes au lendemain de la déclaration de
guerre.
Pour conclure, TH. Zeldin s’interroge sur
l’école de la République dans son Histoire des passions françaises et
écrit : « Dans quelle mesure les écoles transformaient-elles les
individus ? C’est une question-clé dans l’histoire de la France, car
l’enseignement s’y substitua presque à la religion ; la foi en ses vertus
atteignit une intensité exceptionnellement élevée. » L’auteur note que les
résultats furent à la hauteur de cette attente mais restèrent sporadiquement
ambigus et ajoute : l’éducation des masses « augmentait leur capacité
de s’exprimer, mais aussi le pouvoir de la presse, qui leur disait ce qu’il
fallait penser tout en parlant en leur nom », cruelle ironie du sort. Le
problème reste d’actualité malgré nombre d’enseignants qui favorisent la prise
de parole et l’esprit d’alternative dans leur démarche, mais attention encore
une fois au paradoxe : Célestin Freinet, qui dénonçait, au nom de l’esprit
critique, « l’idolâtrie de l’écriture imprimée », avait fait du texte
imprimé par ses élèves, le pivot de l’activité scolaire.
Conclusion :
la clarté d’une démarche écomuséale
On se gardera bien de conclure que cette
école de la Troisième République (dont nous sommes la vitrine) qui en apparence
devait libérer les consciences n’était en réalité qu’un enfermement dans un
dogme. Ce serait une erreur car l’analyse dialectique ne supprime pas la
contradiction. L’école elle-même complexe et contrastée, ne produit pas
d’effets univoques, il faut s’attendre à des effets opposés et les mettre à
jour par honnêteté et soucis de la clarté du discours. De cette démarche
découle la spécificité du Musée de la Maison d’Ecole. Le mot de la fin, qui ne
l’était pas il y a plus de 30 ans et qui est toujours d’actualité, revient à
nos prédécesseurs du premier groupe de travail de Cent ans d’école :
« Juxtaposition et comparaison constantes d’objets et de
disciplines amènent d’abord un flux de souvenirs puis, très vite, une réflexion
approfondie sur les problèmes de l’éducation. Permanente et évolutive, l’exposition
ne se veut, ni éloge ni critique systématique d’un passé encore trop proche
pour en mesurer l’impact définitif, ni éloge ni critique systématique de
l’école contemporaine. Ni passéisme nostalgique, ni triomphalisme vain :
il faut essayer de saisir, à travers la
confrontation de types d’éducation scolaire de ce dernier siècle et hors
de toute polémique partisane ou stérile, comment et de quelle façon, l’école
est le reflet de la société qui la secrète… et inversement ».
Cet article s’appuie sur les minutes du
groupe de travail de la Maison d’Ecole depuis 1974, groupe auquel ont participé
activement, outre l’équipe locale : Pierre Caspard, Serge Chassagne, Georges
Duby, Yves Lequin, Jasques Ozouf, antoine Prost, Guy Vincent…
P.P




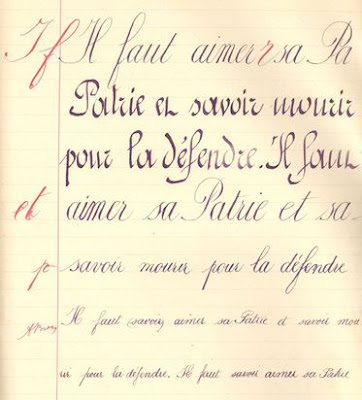




Félicitation pour cette enrichissante présentation patrimoniale et historique de vos collections.
RépondreSupprimerFélicitation pour cette enrichissante présentation patrimoniale et historique de vos collections.
RépondreSupprimerD'un adhérent du musée de Vergné (17)